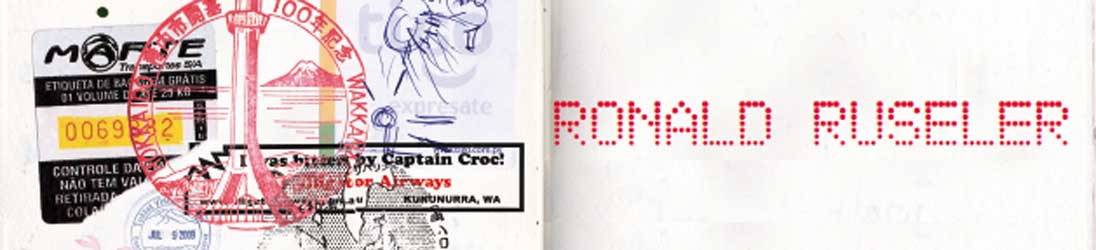La maison verte où Couzijn van Leeuwen (1959) fait ses sculptures se trouve sous de hauts hêtres d’un domaine à Driebergen.
A l’intérieur, c’est un monde fantastique silencieux qui, comme dans un conte de fées, s’éveille à la vie. On passe prudemment devant des armoires en carton et des pots en céramique où des grenouilles rampent dans le feuillage d’argile. Sur les murs de l’atelier, sont accrochés des reptiles de toutes tailles. Toutes sortes de coléoptères sont épinglés à côté de grandes salamandres accrochées au mur comme on les trouve sur le plâtre rongé d’humidité dans les chambres d’hôtel sous les tropiques .
L’atelier de Couzijn van Leeuwen est une sorte de cabinet de curiosités comme il en existait d’autrefois. Ses vases, assiettes et animaux exotiques, paons, grues ou carpes dansent sur leur socle, rappelant les animaux empaillés des musées oubliés aux vitrines pleines de trésors ; et les armoires des vieilles maisons coloniales. Au premier regard, vos œuvres créent une atmosphère inhabituelle.
De quelle manière procédez-vous ?
J’utilise du carton, du papier d’emballage, des kilomètres de ruban adhésif et des multitude d’agrafes. Regardez ! Les animaux que je crée en ce moment, je les ai fabriqué à partir de matériaux que j’ai à portée de main : les salamandres sont en écorce d’arbres, les insectes en feuilles d’artichaut séchées et les grenouilles en pelures d’oranges.
Une manière de donner une nouvelle vie à des choses qui sont mortes…
C’est ma manière d’aider l’évolution et cela nous mène à un plan différent, au-delà de la mort et de la décadence. Par mon travail, la peau d’orange devient peau de reptile ; l’écorce d’arbre vit dans une bête ; les empreintes en plâtre des nervures des feuilles continuent à pousser sur mes vases. Par mon travail, je redessine le monde. Pourquoi est-ce que je m’entêterais à construire quelque chose alors que ça existe déjà ?
Vous donnez l’impression que tout ce que vous faites provient de votre expérience personnelle.
C’est vrai. Tout ce que j’invente est le résultat d’une découverte fortuite lors d’une promenade ou d’un autre moment inattendu. Un artiste a besoin de rendre son espace mental aussi grand que possible. Lorsqu’on regarde très attentivement, on peut se laisser pénétrer par toutes les impressions qui vous viennent à l’esprit. L’intensité de mon travail vient de mon expérience, comme dans le conte de fées dans lequel un garçon se réveille sachant qu’il doit chercher quelque chose, mais ne sait pas ce qu’il doit chercher. Ainsi je m’ouvre à l’inconnu que je cherche, sinon je ne peux pas faire grand-chose, parce que je m’intéresse principalement au moment délicieux de la découverte. Et dans mon atelier, les matériaux trouvent une nouvelle liberté.
Vous vous référez dans votre travail à des lieux lointains, qu’ils soient historiques ou réels.
On m’a suggéré d’aller à Bali voir l’art traditionnel auquel je pourrais m’identifier. Des communautés villageoises entières travaillent ensemble pendant la période des crémations rituelles sur des papiers multicolores. Ils n’ont qu’une fonction cérémonielle temporaire et finissent dans les flammes ou disparaissent, de sorte que des mois de préparation ne laissent que des souvenirs. J’apprécie l’artisanat traditionnel et l’art populaire qui sont pour moi des sources logiques et naturelles, mais je n’ai pas besoin d’aller à Bali, j’y suis déjà allé dans mon atelier.
Est-ce le caractère éphémère de ces rituels qui vous inspire ? Vos installations n’existent souvent que le temps de l’exposition.
En 2002, j’ai créé une cave en carton à partir d’images du graveur du XVIIe siècle, Giovanni Battista Piranesi. L’installation était une reconstruction méticuleuse à l’échelle dans la chapelle d’un ancien monastère. J’ai eu la même démarche pour l’installation De Scheerschuur (La Bergerie) : je suis parti d’une photographie du National Geographic d’un hangar quelque part en Patagonie et j’ai construit les tôles ondulées en carton ondulé. Du papier déchiqueté m’a servi à faire les ballots de laine et j’ai tout fixé à l’agrafeuse. J’ai peaufiné les moindres détails
Les agrafes, le ruban adhésif et l’odeur de la colle chaude formeraient-ils donc votre palette ?
J’aime qu’on rentre dans un musée et que, soudain, on se trouve dans une pièce en carton avec un plancher plus mou que d’ordinaire. On ressent une atmosphère différente autour de soi : l’odeur est autre, l’acoustique plus feutrée. Le visiteur est alors dans une situation où avec ses yeux, ses oreilles, son nez, son toucher, il reçoit de nombreuses impressions subtiles, réagit et peut en tirer sa propre conclusion. Cela ne me dérange pas que mes installations finissent à la décharge après une exposition. Est-ce vraiment dommage que toute cette beauté n’existe plus ? Je trouve toujours cette idée rafraîchissante qu’en partant de la nature je peux mettre à nu un nouveau monde, car la nature, elle non plus, n’en a jamais fini.
Ronald Ruseler 2018
traduction Frédérique Le Graverend